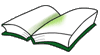CDI de l'IFSI
Bienvenue sur notre catalogue en ligne !| Titre : | Dossier thématique : vécu de soignants en milieu palliatif |
| Auteurs : | S. Behaghel, Auteur ; G. Belouriez, Auteur ; M.-A. Bourc, Auteur ; V. Le Coz, Auteur ; Y. Pochet, Auteur ; M. Santos-Cloarec, Auteur ; A. Chanard, Auteur ; G. Gourmelon, Auteur ; M. Quere, Auteur ; A. Tallec, Auteur ; M. Vigouroux, Auteur ; C. Draperi, Auteur |
| Type de document : | périodique, article |
| Année de publication : | 2010 |
| Format : | pp.77-101 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 616.029 |
| Mots-clés: | soins palliatifs et accompagnement ; altérations corporelles ; blessures narcissiques ; schéma corporel ; réflexions cliniques ; toilette mortuaire ; rituels en soins palliatifs ; mort propre ; toute-puissance ; inconscient ; angoisse de mort ; trauma ; narration ; équipe soignante ; soins palliatifs |
| Résumé : |
- Investir un corps altéré : témoignage d'une équipe en unité de soins palliatifs
Cet article témoigne d'une réflexion théorico-clinique concernant de possibles réactions face à des altérations corporelles importantes en fin de vie. Animés par un souci éthique, différents professionnels d'une unité de soins palliatifs considèrent l'accompagnement qui peut être proposé à des patients dont le corps présente des dégradations massives. A un niveau théorique, la question est appréhendée à travers les concepts de schéma corporel et de blessures narcissiques. A un niveau pratique, l'approche est illustrée par la présentation de l'accompagnement de deux patients. - Réflexions sur la toilette mortuaire : retour vers un partage du rituel Quelques membres de l'équipe de l'USP de XXX, quatre infirmières, une aide-soignante, la psychologue et un médecin ont mené une réflexion sur les rituels entourant la toilette mortuaire. Pourquoi avoir choisi de réfléchir à cette question ? Au centre hospitalier de XXX, lorsqu'un patient décède, ce sont les soignants qui restent en première ligne pour s'occuper de lui et accompagner la famille. Cet aspect est notable. En effet, dans les grands établissements hospitaliers, une fois le décès constaté, les corps sont conduits à la chambre mortuaire où les derniers soins sont réalisés. En revanche, à XXX, cette toilette est faite par un binôme aide-soignante/infirmière ou, plus souvent, aide-soignante/aide-soignante. A l'USP, c'est le binôme aide-soignante/infirmière qui s'en charge. Il y a quatre mois, le médecin responsable de l'USP et la psychologue se sont posé la question d'inclure les proches dans ce soin ultime. Or, faire une toilette mortuaire n'est pas un soin anodin. En majorité, cette idée a choqué. Néanmoins, quelques infirmières et aides-soignantes y avaient déjà songé. Ce moment a été le point de départ d'une réflexion sur les fonctions d'une toilette mortuaire, sur ses significations, sur les différentes manières de la réaliser, sur le vécu des soignants, sur la possibilité d'y inclure la famille et les proches... Un matériel important a été récolté. La recherche s'est révélée fructueuse et les échanges riches. Cependant, de manière à présenter un discours pertinent, le propos se limite à répondre aux questions suivantes. Comment apprêtait-on les morts en Basse-Bretagne au début du XXe siècle ? Comment procède-t-on aujourd'hui à l'hôpital ? Inviter les proches à participer est-il susceptible de favoriser le travail de deuil ? Quels sont les intérêts et les limites ? Quelles seraient les conditions d'un bon partage de ce rituel ? - Appréhender sa mort en se séparant de la toute-puissance. Apports freudiens. Se reconnaître mortel ne va pas de soi. En effet, la mort propre s'oppose à nos voeux de toute-puissance. De manière générale, ce qui s'oppose à la toute-puissance est source de vexation ou de blessure narcissique, voire de trauma. Pourtant, au cours d'une vie, différentes réalités (découverte de l'objet, de l'altérité des sexes...) confronte à la limitation de sa puissance et à l'élaboration de la séparation qu'elle sous-tend. La reconnaissance et l'élaboration de sa propre mort se situerait au niveau du conscient, du Je. Dans l'inconscient, la mort propre serait irreprésentable. Fonctionnant en processus primaire, l'inconscient se conduirait comme s'il était immortel. Dans cet ordre d'idée, Freud conçoit l'angoisse de mort comme une angoisse de mort psychique causée par un abandon du Je par le sur-Je. Plus précisément, un effondrement du sur-Je, en tant que figure toute protectrice, provoquerait une mort du Je. Se défaire de la toute-puissance en passant par la séparation des figures grandioses du sur-Je et par son élaboration permettrait des défenses plus souples. En conclusion, à partir de ce développement théorique, nous envisageons quelques conséquences pratiques concernant l'accompagnement des patients atteints d'une maladie grave. - La narration au sein d'une unité de soins palliatifs Si l'on conseille volontiers aux futurs médecins et soignants d'écouter leurs patients, on ne leur apprend pas à le faire. La parole de la souffrance - celle des patients comme celle des soignants - est classiquement déléguée au psychologue, pour être mieux mise entre parenthèses dans la démarche soignante elle-même. Généralement, il en résulte qu'il est attendu du psychologue qu'il permette au système de fonctionner, au lieu de poursuivre sa finalité propre en s'attachant aux conflits intérieurs, aux résistances et aux désirs de chacun. En amont de ces constats, ce travail présente une étude de la mise en place d'un service de soins palliatifs, où l'on s'est efforcé de mettre la narration au centre de la prise en charge. A travers la prise en considération de la mise en récit des personnes accueillies et de leur entourage, d'une part, et le travail de narration des soignants dans la construction interactive de l'équipe, d'autre part. Il s'agissait de ménager une place privilégiée au sens de l'expérience vécue dans la pratique. L'approche herméneutique permet d'aborder ces témoignages, ce savoir existentiel de chacun, en-deçà de toute interprétation psychanalytique des processus inconscients, pour prendre en compte la logique dans laquelle chacun est impliqué. Seront notamment interrogés : les difficultés soulevées par un changement essentiel dans le fonctionnement de l'équipe par rapport au modèle classique (sociologiquement hiérarchisé et médicalement inféodé au paradigme curatif), la fécondité de ces modalités nouvelles d'interaction, leurs répercussions effectives sur l'accompagnement des patients et de leur entourage, et la possibilité présumée accrue pour le psychologue de trouver sa place singulière dans ce contexte. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 101315 | 616.029 BEH | Périodique | Ouvrages | Disponible |